MICHAEL ROEMER : AMERICAN TRILOGY
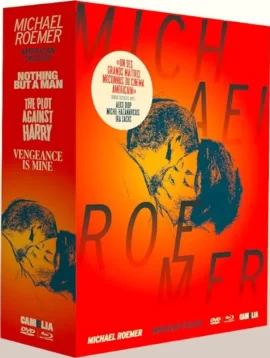
Nothing but a man, The Plot against Harry, Vengeance is mine – Etats-Unis – 1964, 1970, 1983
Support : Bluray & DVD
Genres : Drames, Comédie satirique
Réalisateur : Michael Roemer
Acteurs : Ivan Dixon, Abbey Lincoln, Martin Priest, Brooke Adams, Trish Van Devere
Musique : Frank Lewin
Image : 1.33, 1.85 et 1.66 16/9
Son : Anglais DTS HD Master Audio 2.0 et 5.1
Sous-titres : Français
Durée : 289 minutes
Editeur : Les Films du Camélia
Date de sortie : 13 mars 2024
LE PITCH
Sud des États-Unis. Duff Anderson, ouvrier, rencontre Josie, institutrice et fille de pasteur. Noirs dans un monde dominé par les blancs, tout ce qu’ils entreprendront pour s’offrir une vie stable s’avérera presque insurmontable, jusqu’à mettre en péril leur couple.
Sortant de neuf mois de prison, le bookmaker Harry Plotnick entend reprendre le contrôle de ses affaires. Au lieu de quoi, sa vie va prendre l’eau pour de bon.
Partant refaire sa vie à Seattle après un divorce houleux, Jo fait brièvement escale à Rhode Island pour dire au revoir à sa mère adoptive. Sa rencontre avec une voisine instable et sa fille de quinze ans va bouleverser ses plans.
Un continent
Tous les cinéastes qui s’autoproclament « maudits » devraient garder en tête le cas Michael Roemer, réalisateur de seulement six films depuis le début des années 1960 (deux documentaires, quatre fictions – dont l’une a bien failli ne jamais sortir des tiroirs !), pour se remonter le moral. D’autant que le bonhomme, envers et contre tout, semble garder le sourire !
Arrivés au cinéma par le documentaire, sous l’influence du documentaire et, si l’on peut dire, « pour » le documentaire, Roemer et son comparse Robert Young (co-producteur et chef opérateur d’à peu près tous ses films) proposent d’abord Cortile Cascino, dont les images de bidonvilles siciliens enthousiasment peu les distributeurs en 1962, ce n’est rien de le dire. Premier écueil. Deux ans plus tard débarque Nothing but a man, qui rencontre un petit succès et semble imposer le cinéaste comme l’un des fers de lance de cette industrie indépendante défrichée par Morris Engel et John Cassavetes dans années 1950. « Succès » parce que le parcours de son personnage central, comme l’expliquera Roemer plus tard, procède d’une approche très américaine qui veut qu’au terme de la narration, un héros malmené ait finalement évolué vers le mieux, passé un cap, franchi une étape. « Petit » parce que choisissant de dépeindre les difficultés de la communauté noire face à la domination à bas bruit des blancs, son audience est d’avance restreinte, à l’intérieur d’une culture très clivée, et s’exportera très mal.
Né juif dans le Berlin des années 1920, Roemer comprend sans doute assez bien le principe de ségrégation pour sympathiser avec la communauté noire du sud des États-Unis au milieu du siècle. On croise dans son film de futurs vedettes en herbes (Yaphet Kotto dans le rôle d’un collègue à la colère rentrée ; « Little » Stevie Wonder – quatorze ans à l’époque – parmi la bande originale…) et quelques comédiens parfois tout à fait amateurs, parfaits du premier au dernier – qu’il s’agisse d’Ivan Dixon et Abbey Lincoln, le couple-phare, ou de Julius Harris bouleversant dans le rôle du père de Duff (et qui, selon les mots de Michael Roemer, « n’arrivait pas à boire une tasse de café et à parler en même temps » lorsqu’ils ont commencé à travailler ensemble, ce qui ne l’empêchera pas de faire ensuite une belle carrière de Black Caesar à Islands in the Stream en passant par Live And Let Die).
La construction dramatique qui rapproche Duff de la population blanche tout en l’éloignant idéologiquement d’une partie de ses semblables vivant dans l’acceptation molle le statu quo, par étapes successives comme autant de briques le murant progressivement dans une solitude néfaste, est exemplaire dans sa démonstration. Elle explique, par exemple, comment un homme pétri de bonne volonté et de principes peut, dans un moment de rejet violent et sous la pression continue de tout un système, se comporter avec sa femme à l’inverse de ce que dicte son tempérament – alors que celle-ci fait constamment montre d’une sagesse et d’une bienveillance admirable. Elle explique aussi comment la docilité, face à l’injustice, fait finalement le malheur de tous : pour les salariés soumis, « se comporter en nègre » est le maître-mot afin de ne pas perdre leur emploi ou se mettre à dos la classe des dominants. Duff n’aura de cesse de refuser cette attitude, quitte à ne plus pouvoir se tourner vers quiconque. L’analyse de Michael Roemer prend toujours soin d’entretenir une dialectique imparable entre sphère privée et sphère publique, entre le drame intime et la condition d’une ethnie. Logiquement, la mise en scène, sobre, cherche (et trouve) constamment la juste mesure entre drame domestique et fresque humaniste – auxquels le caractère tranquille de Roemer ne fournit jamais les armes pour se tirer une balle dans le pied, se méfiant tout autant du pathos fabriqué que du pamphlet didactique. Néanmoins le constat est là : le racisme appelle le racisme ; l’oppression appelle la violence – d’abord envers soi-même…
Le juif errant
Le pathos, on aurait pu le trouver aussi dans ce portrait du maladroit Harry Plotnick sur la pente descendante, qui s’enfonce dans des sables mouvants à mesure qu’il tente de s’en extraire, s’efforçant de renouer avec sa famille et de régler ses affaires… mais l’ironie contamine trop The Plot against Harry pour impliquer sérieusement le spectateur dans les mésaventures de ce bookmaker juif tout juste sorti de prison (mélange réussi, dans une version « soft » et plus réaliste, de Woody Allen pour la mollesse et Peter Sellers pour le flegme décalé), dont tout le monde semble faire son possible pour qu’il retourne aussi sec derrière les barreaux. C’est l’histoire d’un homme qui n’a tiré aucune leçon de son passé et se condamne de lui-même à une sorte de purgatoire. Un homme qui deviendra « la honte du peuple juif ». D’emblée, son homme de main arrive en retard pour l’accueillir à sa sortie de prison et, en effet, c’est sous le signe du retard que le personnage évoluera, ne faisant jamais ce qu’il faut au moment adéquat. Julius Harris est encore de la partie, dans le rôle d’un concurrent dur en affaires, ainsi qu’une galerie d’acteurs et d’actrices hauts en couleur gravitant tout autour de Martin Priest, comédien génial, à la nonchalance irrésistible qu’on ne soupçonnait pas lorsqu’il incarnait brièvement, dans Nothing but a man, un chef de bande qui cherchait la bagarre dans une station-service. Où l’on a confirmation que Michael Roemer est un homme de fidélité, de troupe, d’affinités électives, qui aime s’entourer de collaborateurs récurrents tant devant que derrière sa caméra.
The Plot against Harry a bien failli ne jamais sortir, refusé à l’époque par les distributeurs et mis au placard par une production insatisfaite du résultat et qui ne savait pas comment le vendre après des projections-test désastreuses. Le film date de 1970 et ce n’est qu’en 1989 que Roemer met la main sur une copie (encore n’est-ce que pour la transférer en vidéo à l’intention de ses enfants !). Devant des retours devenus encourageants, il décide de faire connaître son œuvre vingt ans après la bataille, présentant ce curieux objet en festivals. Ce retard ne jouait pas a priori en sa faveur, mais contre toute attente il remporte un succès mérité à New York et Toronto, ce genre de satire rétro étant mieux comprise après le passage plébiscité des films de mafia scorsesiens (Mean Streets, Les Affranchis…) et la fibre nostalgique aidant.
Rien ici de cette gravité de ton qui caractérisait le film précédent et qu’on retrouvera dans Vengeance is mine. La présentation à l’écran de sa propre communauté invite Roemer à plus de légèreté. Bien sûr il profite des mésaventures de son « héros » pour filmer très longuement une bar-mitsvah (suivi d’un défilé de sous-vêtements incongru) puis un mariage, et même une amusante cérémonie d’intronisation dans une société secrète ! Mais tout ici se fait sous le signe de la satire. Satire des mœurs, des traditions, de la justice et des médias, avec une goutte de vitriol très diluée dans la bienveillance. Comme pour fournir une transition entre deux films qui semblent faire le grand écart, les premiers figurants que l’on voit sont noirs – apparemment chargés des tâches manuelles et ménagères dans la prison où Harry Plotnick est détenu. Ce glissement d’ethnie est aussi glissement de tonalité : rions un peu, pour ne pas trop pleurer. « Julie » alias Julius Harris ne sera pas ici le paumé alcoolique de Nothing but a man, mais un magouilleur installé, heureux en affaires et bien mis. Et certes le destin s’acharnera sur Harry, qui devra expier ses péchés dans une dernière partie désopilante, mais s’il emprunte la trajectoire inverse de Duff, la contemplation de son déclin n’est jamais une souffrance pour le spectateur, bien au contraire !
Deuil et mélancolie
En 1984, bien après Nothing but a man mais avant la résurrection inespérée de The Plot against Harry, n’ayant réalisé entre-temps qu’un documentaire (Dying) et une fiction avec Christopher Lloyd écrite et réalisée dans la colère (Pilgrim, Farewell), Michael Roemer s’adjoint les services de Brooke Adams, actrice-culte des seventies (Shock Waves, Les Moissons du Ciel, L’Invasion des Profanateurs…) et livre son drame le plus violent et le plus virtuose. Le premier en couleurs, aussi. Toujours fondée sur la recherche journalistique et le naturalisme, la démarche créatrice de Roemer se double ici, ponctuellement, d’un petit pas de côté vers le formalisme du genre, qui montre ce qu’aurait pu donner un cinéaste de ce calibre au service d’un récit d’horreur, d’un thriller ou d’un mélodrame.
Violent par la tension qu’imprime Donna, personnage de femme bipolaire jouée par Trish Van Devere, Vengeance is mine (d’abord titré Haunted pour sa diffusion sur petit écran) est virtuose à plusieurs titres : d’abord dans son écriture dense, qui voit s’empiler sans aucune lourdeur les portraits de personnages croqués parfois en quelques secondes, quelques minutes, tout prêts à faire bifurquer le film vers autant de sous-intrigues, dans une construction dramatique pleine de ramifications éclairantes mais qui ne perd jamais le fil ténu du récit. Et puis, les plans généralement « discrets » de Michael Roemer se font à l’occasion expressifs, symbolistes, créant des couches évidentes de discours ou de tension supplémentaires alors que sa méthode l’avait porté jusqu’ici à éviter les effets et à dissimuler la présence de sa mise en scène.
Qu’à cela ne tienne : la personnalité de l’auteur n’a pas disparu, loin s’en faut. Cinéaste des rituels religieux, Roemer filmait déjà des transes protestantes dans Nothing but a man qui permettaient aux opprimés de déchaîner leur rage contenue ; on a parlé de la bar-mitsvah et du mariage de The Plot against Harry au cours desquels se nouaient et se dénouaient les intrigues ; c’est ici, dans un film plus funèbre et tourné vers le deuil, la lithurgie catholique et le sacrement d’extrême-onction qui marquent des étapes sur le chemin de croix de Jo, jeune femme abandonnée à la naissance, doublement rejetée par sa mère d’adoption – car Roemer aime explorer les crises familiales. Tous ses protagonistes sont déracinés, déracinent eux-mêmes ou sont témoins de déracinements. Duff, dont la seule ascendance était un père démissionnaire duquel ne se dégageait aucune tendresse, menaçait de reproduire le schéma avec son fils (refusant de s’en occuper après que sa mère s’était évanouie dans la nature). Harry Plotnick, à sa sortie de prison, se découvrait une progéniture insoupçonnée dont il tentait, un peu tard, de se rapprocher. Jo, fuyant un mariage toxique pour aller travailler à l’autre bout du pays, débute le film en visitant celle qui l’a douloureusement élevée, afin de lui dire adieu et de régler pacifiquement des comptes. Ce pèlerinage lui fera également rencontrer sa mère biologique. Rien de magique ne se produira, évidemment. Mais elle choisira de prolonger ce qui ne devait être qu’une escale, au contact d’une famille là encore dysfonctionnelle : celle de Donna, en instance de divorce, dont les troubles mentaux font vivre un véritable enfer à sa fille et à son ex-compagnon. Dans le film précédent, lorsque la voiture de Harry Plotnick percutait celle conduite par son ex-beau-frère, lequel véhiculait également son ex-femme, ainsi qu’une fille qu’il n’a jamais connue, son gendre, et même sa petite-fille (encore plus inconnue au bataillon !), on pouvait lire au-dessus de leur voiture accidentée le slogan d’une publicité pour une marque de whisky : « always in the center of things » ! Oui, dans le cinéma de Michael Roemer, la famille est toujours le centre de toutes choses. Difficile à saisir, jouant sur un grand nombre de cordes sans craindre la dissonance, Vengeance is mine est un excellent film qui creuse encore, avec d’autres outils, le sillon des individus enfermés dans leur condition, peinant à s’en extraire. La condition ethnique, sociale, celle du délinquant, de l’orpheline, celle de la déficience psychologique…
En seulement trois longs-métrages, c’est un grand continent que brasse Michael Roemer, avec ses figures, ses approches, ses tonalités disparates, mais aussi ses frontières précises et évidentes. Trois films qui font état d’obsessions nettes, portées par des capacités multiples.
Image
De qualité variable, et aussi consciencieux que soient les récents transferts, la facture visuelle des films dépendent de l’état des copies – et on se souviendra que les travaux de Michael Roemer ont souvent été injustement remisés (voire carrément détruits) sans jamais faire l’objet d’une attention particulière jusque très récemment. Dès le début, pour Nothing but a man, ça se gâte ! Les éléments d’origine ont de toute évidence souffert des ravages du temps, la copie révèle de nombreuses rayures et une luminosité instable d’entrée de jeu, une pellicule abîmée sur laquelle le transfert, fort heureusement, n’en maquille pas les cicatrices à coups d’artifices numériques. On prendra son parti d’une archive certes inégale, quelque peu mutilée, mais qui accroît finalement l’aspect « vérité » de l’œuvre et n’enlève donc rien de sa force (ni de sa lisibilité). Quand à la satire juive qu’on a bien failli ne jamais voir, elle s’en tire avec des honneurs surprenants : propre, profonde, d’un beau noir et blanc tout en nuances de gris à la définition parfaite, la copie de The Plot against Harry est tout bonnement bluffante après une quarantaine d’années passées aux oubliettes ! Quant à la restauration du plus récent Vengeance is mine, très belle et naturelle, avec une restitution des couleurs et un piqué plus que satisfaisants (y compris lors de séquences nocturnes à la photographie soignée), auxquels les micro-imperfections propre à la pellicule qui subsistent donnent d’autant plus un cachet d’authenticité, c’est encore une fois une réussite. On espère bientôt le même travail sur le toujours inédit Pilgrim, Farewell !
Son
Dans deux cas sur trois, une bande-son 2.0 d’origine contient son lot de petits sifflements et de rendus forcément datés, mais la clarté du tout sans souffle ni vrai défaut désagréable emporte largement le morceau malgré le relatif manque de relief. Ironiquement c’est la piste 5.1 revue et (pas très) corrigée de The Plot against Harry qui accuse le coup, avec quelques passages plus grésillants – mais rien de bien grave non plus.
Interactivité
Répartis sur les trois galettes, plusieurs entretiens donnent une vision assez panoramique du cinéma de Roemer quand on les croise entre eux. D’abord une interview de Michael Roemer lui-même, qui revient pendant près d’une demi-heure sur son passé, les débuts du « cinéma vérité », sa conception de la mise en scène et sa trop brève filmographie, mêlant à cela des éléments d’histoire américaine et de philosophie personnelle plus généraux. Outre la pertinence et l’intérêt factuel de ses propos, on notera le calme et l’espièglerie d’un cinéaste lumineux et serein, à des années-lumière du numéro d’artiste maudit, de génie incompris, qu’auraient volontiers servi d’autres réalisateurs trop oubliés pendant de trop longues décennies.
Concernant Nothing but a man, c’est la réalisatrice Alice Diop qui rend compte d’un film découvert très tard (tout récemment, en fait), dont la projection l’a bouleversée jusqu’à croire (légitimement) que le réalisateur était noir lui-même, et dont elle dépeint avec passion la mécanique d’écriture, les personnages et l’atmosphère viciée.
Pour The Plot against Harry, c’est Michel Hazanavicius, amoureux de comédie sous toutes ses formes, de cinéma américain et de culture vintage, qui s’y colle joyeusement, ne manquant pas de convoquer la comparaison avec Martin Scorsese et pointant les petites originalités du film, comme cette façon de ne jamais jouer la mythologie des truands, d’assumer un rythme de déambulation, connectant son esthétique à d’autres références – notamment françaises.
Sur la dernière galette, un autre document donne la parole à Roemer lui-même : une archive de 2022 où le réalisateur et Brooke Adams étaient invités à prendre la parole à propos de Vengeance is mine (trente-huit ans après la sortie du film, donc) suite à une projection publique. Outre leur complicité touchante, les réponses de Roemer éclairent de nouvelles zones de sa carrière et de son identité artistique, les activités d’écriture et de peinture de Brooke Adams sont évoquées, tandis que la genèse du film est rapportée précisément.
Enfin, c’est Ira Sachs qui dissèque le film à sa manière quasiment psychanalytique et très sensible, jetant des ponts entre l’enfance de Roemer, sa culture, et les thèmes de Vengeance is mine, citant Fassbinder, Godard, Brecht, Bergman, Shakespeare, mettant l’accent sur l’étrangeté imprévisible de ce film au contenu inépuisable.
Liste des bonus
Entretien avec Michael Roemer (27′) ; Entretien avec Alice Diop (18′) / Entretien avec Michel Hazanavicius (19′) ; Conversation entre Michael Roemer et Brooke Adams (19′) / Entretien avec Ira Sachs (21′) ; Trailers des trois films ; Bande-annonce de la rétrospective.













