LES MOISSONS DU CIEL
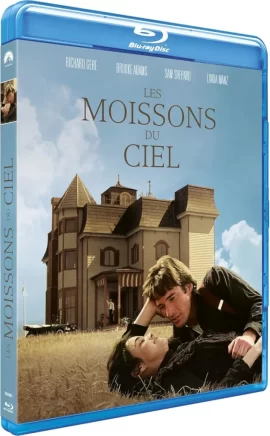
Days of Heaven – Etats-Unis – 1978
Support : Bluray
Genre : Drame
Réalisateur : Terrence Malick
Acteurs : Richard Gere, Brooke Adams, Sam Shepard, Linda Manz…
Musique : Ennio Morricone
Image : 1.85 16/9
Son : DTS HD Master Audio 2.0 Anglais et FrançaisSous-titres : Français
Sous-titres : Français
Durée : 94 minutes
Editeur : Paramount Pictures France
Date de sortie : 26 mai 2021
LE PITCH
Au début du vingtième siècle, un ouvrier flanqué de sa petite sœur et de la femme qu’il aime (et qu’il fait également passer pour telle) se fait embaucher sur la propriété d’un jeune et riche fermier condamné par la maladie. Ce dernier convoite également la « sœur » de son employé. Les rapports de tous ces personnages vont se charger d’ambiguïté au rythme des saisons passées ensemble.
Entre ciel et terre
Perdu dans une décennie où l’on aime à penser que le cinéma américain a surtout été paranoïaque, contestataire, citadin, poisseux et désenchanté, Les Moissons du Ciel occupe une place très particulière, celle d’une alternative distanciée, contemplative, aux maux qui travaillaient la plupart des autres films de façon plus abrasive. Sans oublier pour autant lesdits maux.
Terrence Malick est un mythe à lui tout seul. Encore l’est-il de moins en moins avec le temps – plus on produit, plus on s’expose, plus le mythe s’émousse… Après avoir surgi au milieu des années 1970 avec deux uppercuts mémorables (l’un complètement dans la mouvance de son temps, l’autre beaucoup moins), l’homme a complètement disparu de la circulation pendant une vingtaine d’années avant de revenir pour un film de guerre parmi les plus marquants et singuliers du genre : La Ligne Rouge. Proche chronologiquement de la sortie d’Il faut sauver le soldat Ryan de Spielberg, Malick y montrait le versant Pacifique de la seconde guerre mondiale, dans un style visuel nettement moins tape-à-l’œil mais avec des ambitions narratives vertigineuses qui faisaient adopter successivement, sur le mode introspectif, les points de vue d’une galerie de personnages au milieu du champ de bataille. Célébrant le retour inattendu d’un cinéaste atypique, le succès de ce (très) long métrage lança Malick dans un rythme de production beaucoup plus soutenu, jusqu’à aujourd’hui. Ses deux « œuvres de jeunesse » des seventies sont La Balade Sauvage, road movie d’apparence nihiliste typique des préoccupations de l’époque, avec un Martin Sheen dénué d’empathie qui, en compagnie de la déboussolée (et toujours géniale) Sissy Spacek, dérouille les gens rencontrés au hasard sur sa route ; et donc ces Moissons du Ciel, nettement plus étonnant en surface par son approche classique et son contexte paysan, qui voit s’affronter symboliquement le superbe Sam Shepard et Richard Gere pour les beaux yeux noirs de Brooke Adams. Les deux titres originaux – Badlands et Days of Heaven – semblent eux-même s’opposer, séparer enfer et paradis, illustrer deux mondes étrangers l’un à l’autre. Encore une fois, tout cela n’est que surface : Le fait de donner pour titre à son premier film le nom (certes évocateur) du gigantesque parc des Badlands, et l’ironie du titre de son deuxième film qui, sur fond de grand domaine céréalier effectivement paradisiaque, raconte le non-dit, la duplicité, les rapports de plus en plus tendus de personnages tourmentés, ont plutôt tendance pour Malick à rapprocher les deux œuvres dans une même exaltation des grands espaces naturels au milieu desquels l’être humain se débat avec ses propres démons – soit la grande ligne de force de tout son cinéma.
Beaucoup de choses ont été dites sur le réalisateur, plus ou moins fausses, en tout cas approximatives, mais toujours révélatrices : on le compare parfois à Stanley Kubrick en raison de sa longue absence sur le marché du film, de son utilisation de la musique de concert à l’intérieur de ses œuvres, de sa méthode à la fois déroutante pour son équipe et dite « perfectionniste »… On lui attribue une obsession pour un « paradis perdu » que serait l’état de nature brut, au sein duquel l’Homme fait figure de parasite. On laisse enfin entendre qu’il tient davantage du photographe que du cinéaste, délaissant excessivement ses personnages et ses histoires au profit du décor, de la lumière, des paysages… C’est, comme toujours, par opposition à ces intuitions que l’on peut préciser les choses : oui il y a du Kubrick chez Malick – mais alors un Kubrick empreint de spiritualité au moins autant que de philosophie, et qui avance pas à pas pour composer le squelette de son film pendant le tournage et au montage (donc, plus vraiment Kubrick !) ; oui il semble y avoir une opposition nature / culture chez Malick – mais alors que faire, dans une vision aussi caricaturale de son propos, des nuées de sauterelles, des prédateurs guettant dans les marais, des catastrophes naturelles, de l’extinction des dinosaures (dont il disserte abondamment) et, à l’inverse, des hommes et des femmes aspirant à l’harmonie et à l’Eden tout au long de sa filmographie…? Quant au complexe du photographe naturaliste, il s’annule de lui-même du moment que l’on décloisonne la vision étriquée que certains peuvent avoir du cinéma et de ce qu’il est censé montrer ou représenter (jadis, n’a-t-on pas osé qualifier David Lean, auteur de l’insurpassable Lawrence d’Arabie, de vulgaire cinéaste « carte postale » ?!). En l’occurrence, Les Moissons du Ciel est surtout l’une des réussites les plus éclatantes d’un cinéma qui parvient à saisir, esthétiquement et sans longues tirades sentencieuses, le vertige et les contradictions de l’être humain dans un environnement qui l’écrase – en quoi il rejoint à la fois l’un des postulats du western, l’essence de la tragédie antique, les préoccupations philosophiques de Rousseau, Kant, Nietzsche ou Thoreau, et pas mal d’autres choses encore ; tout cela ancré dans la plus pure tradition Americana.
Innocence
Le fait de filmer, comme dans Badlans, un couple en cavale qui tue à répétition sans motif apparent perturbe toujours une certaine critique et un certain public du moment que le réalisateur ne se pose pas en juge avec évidence. Le sens de la morale du cinéma américain, hérité de Cecil B. DeMille, s’en trouve tout ébranlé – Oliver Stone, beaucoup plus tard, en fera encore les frais avec ses Tueurs Nés à la tonalité satirique pourtant criante. On pourrait retourner le problème et faire remarquer qu’à l’inverse, Malick – à défaut de surligner au stabilo la barbarie de ses protagonistes (leurs actes frontaux ne suffisent-ils pas ?) –, ne les romantise pas non plus comme dans le fascinant mais plus tendancieux Bonnie & Clyde d’Arthur Penn. Il a d’ailleurs de bonnes raisons de se détacher de ses personnages. On retrouve dans Days of Heaven cette même mise à distance qui désamorce à la fois l’émotion brute et répulsive de séquences qui devraient être codifiées comme violentes, et l’empathie des spectateurs pour les « héros » de l’histoire. On peut le regretter comme un fauve affamé de spectacle qui attend qu’on lui serve la soupe – ou bien, plus raisonnablement, remarquer que de cette mise à distance découle une vision de cinéaste qui prend l’être humain de très haut, n’accordant guère plus de crédit à ses dilemmes et à ses déchirures qu’on ne le fait aux caprices d’un enfant en bas âge. Pour Malick, l’Homme est jeune, inapte, peu éveillé : même lorsqu’il tue, qu’il trompe, qu’il frappe ou qu’il guerroie… il le fait en toute innocence ! La tragédie du monde tel qu’il le voit, c’est que l’innocence n’est ni pure ni pacifique : elle est cruelle et tourmentée. Certes la ville, l’évolution humaine industrieuse où se développe la cupidité, on la quitte très vite ici, à la suite d’une bagarre avec un supérieur hiérarchique, pour se réfugier dans une campagne moins peuplée, apparemment salvatrice. Très « flower power », tout cela… Sauf que les champs immenses, à perte de vue, que le cinéaste se plaît à montrer et dans lesquels viennent travailler Bill / Richard Gere, Abby / Brooke Adams et d’autres ouvriers, sont moins filmés comme un Eden que comme une eau qui dort. Leurs remous agités par les éléments, au son de la merveilleuse musique de Morricone dont l’un des thèmes est dérivé de l’Aquarium du Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns (le morceau original ouvre et ferme le film comme pour signifier qu’il s’agit d’un simple coup d’œil à travers la paroi du bocal), semblent cacher autant de menaces que de promesses. Les insectes en surgissent pour dévorer les cultures comme la trahison, la jalousie, la soif de vengeance, jaillissent par fulgurances incontrôlées de personnages qui ont pourtant tout pour vivre heureux, ensemble, loin de l’agitation de la foule. « Ensemble » – mais l’enfer, c’est toujours l’Autre…
Une extrême majorité de réalisateurs filment en hommes qui réfléchissent sur les hommes, ou en hommes qui réfléchissent avec un point de vue d’homme sur les femmes – ou, plus rarement, en hommes qui tentent d’adopter un point de vue poussivement féminin sur la condition féminine. Sans trop exagérer, on pourrait qualifier Terrence Malick (ça le distingue assez de la plupart de ses confrères et caractérise assez son cinéma pour être mentionné) de réalisateur à la sensibilité profondément féminine qui réfléchit principalement sur la gent masculine. Les femmes sont chez lui, bien souvent, des observatrices avisées, impuissantes, mélancoliques, de la folie des hommes. Ici, l’histoire est contée en voix over par une narratrice, la petite sœur de Bill interprétée par une Linda Manz au visage impassible et sublime, constamment en retrait mais dont l’œil aiguisé ne laisse rien échapper des événements – une alter ego de l’auteur. Connectée à une vision du monde plus grande qui survivra au récit, jamais en proie aux pulsions destructrices ou à l’instinct de possession réservés aux personnages masculins, elle décrit ces derniers sans vraiment se les expliquer, comme un ange dépassionné, tour à tour vaguement attendri ou désolé par tant de désordres amoureux et de rivalité mal placée, mais pour qui l’issue des destins est tellement prévisible qu’elle n’y investit ni son cœur ni ses nerfs. Et le réalisateur de poser explicitement sa sempiternelle question : « Pourquoi ? » – pourquoi la violence, pourquoi la jalousie, pourquoi la guerre ? Hanté par les mêmes questions, Stanley Kubrick (il suffit de regarder la structure de ses films) possède les réponses dès l’écriture et est en mesure de nous les donner. Malick, au bout de quarante-cinq années de cinéma, semble encore les chercher…
Histoire minimaliste, économe à l’extrême, qui tutoie pourtant l’énergie du cosmos, Les Moissons du Ciel est un pur joyau qui donne une voix bien à part au vertige existentiel à l’œuvre dans l’époque troublée de sa réalisation. Son mélange d’une mise en scène qui ne semble pas mettre l’humain au centre des préoccupations, et d’une narration qui désamorce l’immédiate empathie des spectateurs et laisse à leur discrétion la façon dont ils orienteront leur propre regard, loin de constituer une série de défauts, est précisément le socle de cette impression très particulière que laisse n’importe quel film de Terrence Malick depuis lors : tout y prend confusément une résonance biblique. Chaque catastrophe y est un signe de Dieu, une punition, une plaie d’Égypte ; chaque écart bestial d’un personnage y est une chute morale, une rature indélébile, une faute originelle. Pourtant très loin de tout moralisme à bon compte, quelque part entre le John Ford humaniste des Raisins de la Colère et le Bernardo Bertolucci désabusé de 1900, Malick signait en 1978 ce qui reste, peut-être, sa plus belle œuvre.
Image
On attendait forcément une copie à la hauteur de la perfection visuelle du film. Sans être époustouflante, celle proposée ici n’accuse aucune faiblesse quant à sa propreté ou sa facture technique générale. On regrettera simplement – réserve très relative – un piqué et une colorimétrie manquant parfois de relief et affadissant quelque peu la magnificence de certains plans. Bref, pas lieu de se plaindre, le travail est bien fait – mais pour Days of Heaven, on en voudrait toujours davantage !
Son
Ni souffle ni saturation, que ce soit sur la version originale ou la vf, et dans les deux cas une bonne mise en valeur des musiques aériennes et mystiques du grand Morricone. La parcimonie des dialogues et le mixage toujours très délicat propre à l’univers de Malick, dans de telles conditions, forment une expérience sonore aussi riche que possible, qui ne brille guère par son impact dans les enceintes, mais saisit par sa précision.
Liste des bonus
Aucun.











